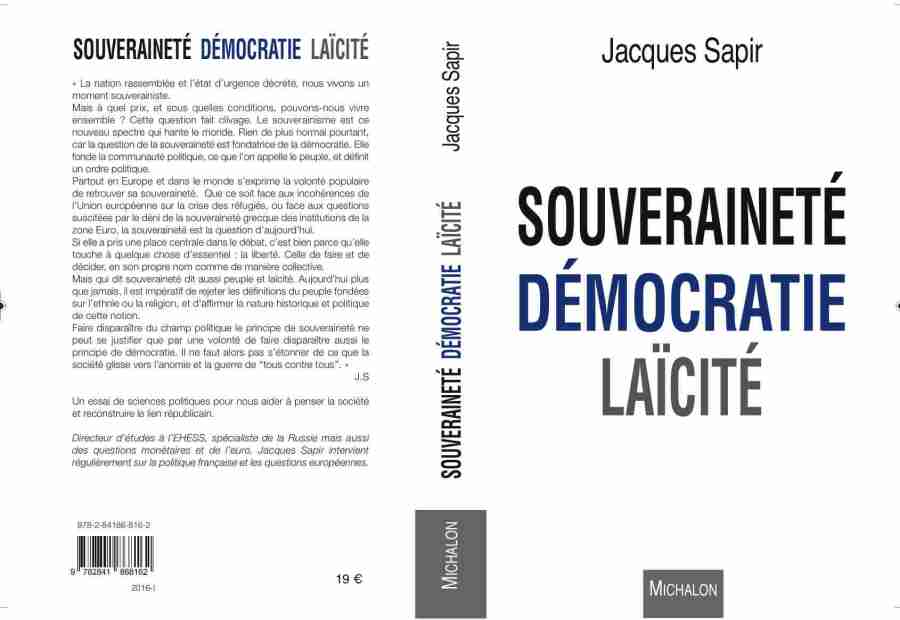
PLAN DE L’ARTICLEA/- Bertrand Renouvin – compte rendu de l’ouvrage Souveraineté, Démocratie, Laïcité[1], compte rendu publié en trois parties ci-aprèsB/- Jacques Sapir théoricien de la souveraineté lui répond …
PARTIE 1 –
« Souveraineté, démocratie, laïcité » : le livre que Jacques Sapir vient de publier (Michalon, 2016) mérite une lecture très attentive en raison des éclaircissements qu’il apporte et des débats qu’il ouvre.
La classe dirigeante qui patauge dans l’idéologie ultralibérale a horreur de la théorie, associée à l’intellectualisme, à l’abstraction qui éloigne des réalités du terrain. C’est oublier la leçon de Kant : pas de bons résultats pratiques sans une théorie aussi juste que possible. Il faut faire le détour par l’abstrait pour agir concrètement – faire des mathématiques pour envoyer une fusée sur la lune.
Ce lien entre la théorie et la pratique n’est pas moins indispensable en politique.
- La capitulation de Syriza en Grèce et le demi-échec de Podemos en Espagne sont d’abord la conséquence d’une théorisation partielle ou erronée conduisant à des faiblesses stratégiques – faute de claire compréhension des enjeux.
- En France, les bévues des dirigeants de la gauche anti-austéritaire privent d’innombrables citoyens de la perspective d’une conquête du pouvoir en vue d’un changement radical de politique.
La vaste mouvance qu’on appelle « nationale-républicaine » ou « souverainiste » attend la personnalité qui saura la rassembler selon des objectifs hiérarchisés. Cette attente n’est pas inactive. De nombreux économistes hétérodoxes sont mobilisés contre l’idéologie du marché. La philosophie de la République s’est réaffirmée à la fin du siècle dernier et diverses écoles ont sérieusement repensé la Nation…
Dans ces beaux chantiers de la reconstruction, Jacques Sapir est en train de prendre une position prééminente qui lui vaut de nombreux ennemis à Paris… et le soutien des millions de lecteurs de son carnet RussEurop. Cette position prééminente est le fruit d’un travail acharné qui lui a permis de présenter une critique radicale des discours normalisateurs sur le marché, la mondialisation et le fédéralisme européen dans la perspective d’un retour à l’économie politique et à la politique économique. Cette perspective a été tracée par Jacques Sapir selon des expériences précises – plus particulièrement la transition russe et le redressement entrepris depuis l’arrivée d’Evgueni Primakov – qui ont enrichi sa réflexion théorique.
De la critique de la « construction européenne » et de l’expérience de l’échec de la zone euro, Jacques Sapir a tiré une stratégie de salut public : la destruction de la zone euro en vue de la relance d’une politique économique et sociale adaptée aux caractéristiques de chaque nation (1).
A la théorie économique, à la projection stratégique, s’ajoute maintenant une théorie politique centrée sur la souveraineté (2). Ces trois aspects de la pensée de Jacques Sapir forment un ensemble cohérent. Cohérence remarquable et même redoutable pour qui veut en rendre compte car il faut brasser maintes pensées et plusieurs siècles pour bien suivre le cheminement d’une réflexion qui peut accueillir apports et prolongements. Bien entendu, la souveraineté peut se dire de plusieurs manières et diverses philosophies permettent d’en affermir le concept. D’ordinaire, le milieu politique envisage la souveraineté en fonction de ce qui a été élaboré pendant et après la Révolution française. Jacques Sapir s’installe quant à lui dans l’histoire longue de la souveraineté, sans en faire une idée exclusive. Comme le titre de son livre l’indique, la souveraineté est pensée dans sa relation avec la démocratie dans le cadre d’une République nécessairement et rigoureusement laïque.
Mon ambition, dans la présente note, n’est pas de comparer des itinéraires intellectuels – celui de la NAR et celui de Jacques Sapir – et de proposer une confrontation, mais de présenter une œuvre qui permet le réarmement intellectuel et politique des citoyens confrontés à une crise totale. L’insécurité sociale, l’insécurité culturelle et l’insécurité physique depuis les récentes attaques « djihadistes » exigent une réponse générale qui doit être élaborée en fonction de deux constats :
- – l’état de violence, la « guerre de tous contre tous » sous prétexte de concurrence et de compétitivité ;
- – l’effondrement des perspectives tracées après la chute du Mur de Berlin : ordre mondial régi par les Etats-Unis, « mondialisation heureuse », « intégration européenne ».
Depuis un quart de siècle, la réponse des partis et mouvements souverainistes est sommaire, voire démagogique : il suffirait de rétablir la souveraineté de la nation et de rétablir nos frontières pour que la situation soit à nouveau maîtrisée – cette maîtrise portant avant tout sur l’immigration. De même que le nationalisme caricature la nation, le souverainisme partisan ignore la théorie générale de la souveraineté. Et le Front national, qui récupère depuis des années des textes de Jacques Sapir, gagnerait en sérieux et en prudence si ses dirigeants étudiaient attentivement l’œuvre d’un auteur qui se déclare souverainiste mais qui charge le terme d’un contenu étranger aux phobies frontistes.
Du pouvoir souverain
La souveraineté n’est pas une idée abstraite qu’on pourrait facilement remplacer par un autre concept placé dans un quelconque « espace » post-national ou post-impérial. Parce que l’homme est un animal politique, la souveraineté repose sur un tissu plus ou moins vaste de relations sociales et donne corps à un peuple de sujets plus ou moins libres ou de citoyens. Ces relations sociales ne se déploient pas dans un espace indéterminé mais sur un territoire délimité – ce que nous savons depuis les Grecs qui ont beaucoup réfléchi sur la limite (péras) et l’illimité (apeiron). Le pouvoir souverain est situé en un lieu – qu’il s’agisse du souverain classique qui est dans son palais, au sommet de la hiérarchie politique ou qu’il s’agisse du peuple souverain qui fait ses choix dans des circonscriptions électorales. Les différentes manières d’exercer la souveraineté impliquent toutes l’existence de frontières à l’intérieur desquelles se développent la dialectique du pouvoir et du peuple.
Comme le souligne Jacques Sapir à partir des observations qui précèdent, l’Union européenne n’a pas engendré un pouvoir souverain ni été engendrée par un pouvoir souverain parce qu’il n’y a pas de peuple européen. Quant aux frontières de l’Union européenne, elles varient au gré des accords (Schengen) et dans leur définition la plus large, elles ne sont qu’une addition de frontières étatiques.
Les collectivités politiques (3) rassemblées sur un territoire délimité ne sont pas angéliques. Elles sont agitées de conflits plus ou moins violents entre les personnes, les groupes et les diverses communautés. Contre les visions unanimistes, Jacques Sapir prend acte de l’hétérogénéité sociale et de la décentralisation économique, qui implique une « incertitude radicale » dans la vie sociale et économique. Les économistes néoclassiques (« libéraux ») ont cherché à nier cette incertitude en établissant un modèle de choix rationnels effectués par les agents économiques en fonction des prix. Ces calculs seraient faits afin de maximiser les avantages individuels. Comme si les hommes étaient des automates intégrant les informations et effectuant des calculs à la vitesse des ordinateurs dans un but égoïste ! C’est faire fi des différents types de rationalité et de l’infinité des désirs… qui nous renvoient à l’incertitude.
Nul ne peut, cependant, s’en tenir au constat de l’incertitude radicale car celle-ci conduit à l’attente indéfinie et paralysante. Il va sans dire que chacun peut faire ses choix personnels. Mais la prise de risque est maximale s’ils sont effectués dans une situation de chaos – celle de la Russie après l’effondrement de l’Union soviétique, celle de l’Albanie en 1997 après l’effondrement des pyramides de crédit. Dans ces situations d’anarchie, les liens sociaux se relâchent ou disparaissent et les contrats passés entre les entreprises sont d’une fragilité extrême faute de juges pour les garantir et de policiers pour les faire respecter. C’est alors que les puissances mafieuses imposent par la violence, leurs propres normes et maximisent leurs profits au détriment des citoyens. A juste titre, Jacques Sapir affirme que le pouvoir souverain ne peut être effectif sans les institutions politiques qui organisent la société. On ne peut cependant se contenter d’une mise en ordre institutionnelle car ce serait accepter qu’une tyrannie garantisse la fin du chaos par l’asservissement généralisé. Pour répondre à l’exigence commune de justice et de liberté, il faut que ces institutions soient légitimes.
(à suivre)
***
(1) On trouvera sur ce blog la présentation de plusieurs ouvrages de Jacques Sapir.
(2) Jacques Sapir, Souveraineté, démocratie, laïcité, Michalon, 2016.
(3) Il semble pertinent de distinguer la collectivité politique, définie comme ensemble d’hommes libres et de citoyens, de la communauté fondée sur l’adhésion à une croyance politique ou religieuse. La collectivité fonctionne selon la dialectique de l’unité et de la diversité, la communauté sur la dialectique de l’identité et de la différence.
(4) « Les économies que l’on appelle de marché sont en réalité des économies décentralisées, c’est-à-dire des systèmes où des actions initiées séparément ex ante doivent trouver des formes de cohérence globale ex post. » Jacques Sapir, Les trois noirs de la science économique, Albin Michel, 2 000. Page 266.
PARTIE 2
C’est le général de Gaulle qui a réintroduit la légitimité dans le souci politique mais la pratique n’a pas précédé la théorie : le Général avait retrouvé dans l’histoire de la France capétienne une exigence qui dépassait les critères strictement juridiques de dévolution de la couronne. Jacques Sapir reprend le mot et donne une pleine signification à l’indispensable concept de légitimité.
De la légitimité
Le pouvoir souverain répond à l’exigence de liberté collective et individuelle. Le pouvoir légitime répond à l’exigence de justice. Pour moi, disciple de Claude Bruaire (1), le point est essentiel : l’essence du pouvoir, c’est l’existence d’une justice. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une légalité – même si la loi est votée selon des procédures parfaitement respectées. Il faut des lois, des règlements, des contrats, des tribunaux et des jugements. Mais une société ne peut être fondée sur des contrats car ils ne peuvent répondre à toutes les questions, présentes ou à venir, telles qu’elles se posent dans les différents domaines de la vie en société. Il faut qu’une institution supérieure soit en mesure de garantir les contrats, de remédier aux incertitudes et de dire le droit dans lequel s’inscrivent les lois et les contrats. Pour situer l’institution légitime qui ordonne la légalité, Jacques Sapir reprend la distinction romaine puis médiévale entre la potestas et l’auctoritas. Il y a le pouvoir d’agir, de rendre possible, et il y a l’autorité gardienne des principes – liberté, égalité, justice – qui justifient les actes.
Je ne peux retracer ici la discussion que Jacques Sapir engage avec Carl Schmitt, auteur d’un ouvrage sur Légalité et légitimité (2) placé dans une problématique catholicisante et anti-démocratique. Le juriste allemand eut le mérite de pointer une faille majeure du libéralisme standard, décentralisateur et antiétatique qui ignore la distinction entre le légal et le légitime. Jacques Sapir élargit cette faille en montrant qu’une société tissée de conduites individualistes et utilitaires, dans laquelle coexisteraient des groupes autonomes, n’est pas possible. Les fortes variations dans les préférences individuelles empêchent tout équilibre de marché et les interactions entre les acteurs sont tellement denses dans les sociétés modernes et tellement soumises à des phénomènes extérieurs ou externalités (3) positives (l’éducation) ou négatives (la pollution) que l’autorégulation n’est même plus pensable. Ainsi, « cette notion de densité économique et sociale implique que des règles, admises par tous, organisent les interactions entre les individus et résolvent les questions qui surgissent de leurs conséquences imprévues. Mais, pour qu’il y ait des règles admises par tous au sein d’une communauté politique donnée, il faut qu’il y ait un principe de légitimité à l’œuvre. Et, pour que ce principe de légitimité puisse exister, cette communauté politique doit être souveraine.» (4).
Le libéralisme standard part de l’individu et ne s’intéresse pas au cadre institutionnel dans lequel il évolue, comme si cet individu était souverain en soi et pour soi. Il est plus pertinent de partir du principe de souveraineté et de l’institution légitime qui assure à l’individu un état de droit : celui-ci lui permet d’être libre et l’inscrit aussi dans toute une symbolique – religieuse, politique, idéologique… – qui influe profondément sur son comportement et ses choix.
De la transcendance
Dans l’histoire de la nation française, le pouvoir politique s’est très longtemps pensé selon une transcendance religieuse – précisément judéo-chrétienne dans la conception du droit, de l’autorité, de la moralité. Or Jacques Sapir récuse toute intervention de la métaphysique dans l’ordre politique : « toute tentative pour faire jouer le rôle d’une croyance scientifique à une croyance religieuse, que ce soit dans ce contexte précis avec la notion de droit immanent ou dans celui de l’harmonisation des intérêts privés par la main invisible, reconfiguration de Dieu chez Adam Smith, pour ne pas parler des méta-valeurs kantiennes invoquées par Hayek, est parfaitement irrecevable » (page 89). Des arguments non-discutables ne peuvent intervenir dans une discussion. Pascal ne s’opposerait pas à cette réflexion : une autorité théologique qui voudrait s’affirmer hors de son ordre et s’imposer à la recherche scientifique serait tyrannique et se condamnerait elle-même puisque sa force propre serait devenue pure violence (5).
Cependant, Jacques Sapir s’appuyant sur les travaux de Maurice Godelier sait bien que la légitimité ne peut pas procéder seulement de la force : il faut qu’elle s’appuie sur un système de croyances et de figures symboliques mais aussi de puissances invisibles qui protègent le territoire des agressions extérieures. Il faut donc des « valeurs communes » (6) fortifiant le pouvoir souverain et les institutions légitimes. Telle était bien la fonction du sacre de Reims, qui ne « faisait » pas le roi mais qui inscrivait la monarchie royale d’Ancien régime dans la foi chrétienne et la religion catholique (7).
Mais qu’en est-il de ces « valeurs communes » dans une nation française qui a connu la fracture des guerres de religion, la Révolution française qui reconnaissait seulement l’Être suprême, et la Séparation de 1905 ?
Pour comprendre le sens de la question, il faut s’inscrire dans l’histoire millénaire de la France car les ruptures dans l’ordre du religieux ou par rapport au pouvoir religieux s’accomplissent dans une France, d’abord royaume puis nation, qui se constitue en État. La constitution de l’État, selon une dialectique complexe et parfois violente, vient compenser les différents modes de désaffiliation religieuse. Jacques Sapir souligne que l’État commence
- à prendre son autonomie avec Philippe Le Bel dans la lutte contre les seigneuries locales et contre le pouvoir temporel de la papauté,
- s’affirme avec Henri IV et trouve en Jean Bodin son théoricien.
Dès le 16ème siècle, dans un régime de monarchie royale, l’État est défini comme une République disposant de la puissance souveraine – cette puissance étant ordonnée au bien commun dans le royaume de France et pour les Français. La pensée de Jean Bodin est capitale pour comprendre comment s’est constituée théoriquement puis pratiquement un domaine public politique affranchi de la transcendance divine – sans que cette déclaration d’autonomie pleine et entière parvienne à résoudre toutes les difficultés (8).
Il reste qu’une dynamique est enclenchée au 16ème siècle qui aboutit à la loi de Séparation de 1905 telle que nous la connaissons… ou croyons la connaître.
Cette Séparation n’en n’est pas une ! Jacques Sapir a raison de l’analyser comme une distinction entre le domaine public et le domaine privé dans le cadre de la démocratie res-publicaine.
- On peut en effet concevoir entre l’État et des communautés religieuses une séparation complète, avec un principe de tolérance mutuelle évitant les conflits inter-communautaires.
- Au contraire, dans l’État res- publicain, les pouvoirs publics et les groupes privés ne sont pas séparés mais distincts parce qu’ils coopèrent avec l’État et entre eux pour la réalisation du bien commun.
Une définition rigoureuse de la laïcité exclut que celle-ci devienne à son tour une religion mais l’État laïc, qui assigne toutes les religions au domaine privé, n’est pas pour autant débarrassé du religieux. Jacques Sapir reprend la vieille question de la loi naturelle, dénonce le dieu caché dans les théories d’Adam Smith et de Léon Walras, conteste René Girard pour mieux réaffirmer l’autonomie du Politique au sein duquel s’articulent la souveraineté et la légitimité, le pouvoir et le peuple, l’État et la nation.
(à suivre)
***
(1) Cf. Claude Bruaire, La raison politique, Fayard, 1974.
(2) Carl Schmitt, Légalité et légitimité, et la présentation par Bernard Bourdin de trois textes de Schmitt : La visibilité de l’Eglise, Catholicisme romain et forme politique, Donoso Cortès, Cerf, 2011. Cf. mon article sur ce blog : http://www.bertrand-renouvin.fr/carl-schmitt-et-la-theologie/
(3) Les externalités « impliquent que le résultat d’une action individuelle soit déterminé ou dépendant, même en partie, de l’effet non-intentionnel de l’action d’autrui. » J. Sapir, Souveraineté… op. cit. page 98.
(4) Jacques Sapir, Souveraineté…., op. cit. page 98.
(5) « La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu’on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites : devoir d’amour à l’agrément, devoir de crainte à la force, devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs‑là, on est injuste de les refuser, et injuste d’en demander d’autres. » Pensées, fragment 58.
(6) « Valeurs communes » : les guillemets sont de l’auteur. Dans un entretien récent, Jacques Sapir distingue les valeurs et les principes : « le monde des valeurs […] ne relève que de la conscience individuelle alors que les principes « sont des règles partagées avec autrui et sur lesquels se fondent les relations politiques qui constituent les bases des sociétés. » http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/01/29/31001-20160129ARTFIG00137-jacques-sapir-l-europe-federale-est-une-illusion-propagee-par-des-elites-retranchees-a-bruxelles.php
(7) C’est la règle de succession dynastique qui établit le roi dans sa fonction. Louis XVIII et Louis-Philippe, qui n’ont pas été sacrés, étaient pleinement légitimes.
(8) Cf. Bernard Bourdin, Le christianisme et la question du théologico-politique, Cerf, 2015. Pages 62-67.
PARTIE 3
Dans d’autres chapitres de son livre, Jacques Sapir fournit toutes les armes – critique des organes de l’Union européenne, théorie des circonstances exceptionnelles – qui permettront de déclencher face à Bruxelles et Berlin une crise salutaire. Je ne reprends pas ici ces éléments décisifs – ils nourriront au fil de l’actualité d’autres chroniques – car je voudrais aujourd’hui pointer ce qui, à mon avis, donne matière à débat.
D’abord la référence au « souverainisme ».
Jacques Sapir lui donne un contenu légitimiste, démocratique et républicain. J’espère, mais je doute fortement, qu’il parviendra à substituer son propre concept à l’acception courante du mot, qui mêle les deux affirmations antinomiques du patriotisme et du nationalisme (1).
Ensuite Carl Schmitt.
Je suis mauvais juge car j’ai toujours contourné le juriste allemand, en dépit des injonctions amicales de deux spécialistes de son œuvre. Il est vrai qu’un royaliste n’a pas besoin de lui pour penser le légal et le légitime mais je reconnais volontiers que le détour par Schmitt peut être pertinent.
Beaucoup de lecteurs de Jacques Sapir apprécieront son double mouvement de reprise et d’opposition qui permet de dégager la notion d’ordre démocratique : à l’opposé du modèle schmittien (page 217), le schéma des formes d’articulation des types de légitimité (page 276) est tout à fait stimulant. Je m’inquiète cependant de la récupération par Jacques Sapir du schéma schmittien Ami-Ennemi, dans son analyse critique du livre que Christophe Barret a consacré à Podemos (2) et je conteste l’analyse faite en ces termes :
- « La lutte contre des élites largement gagnées par la compradorisation, ou contre une bourgeoisie ouvertement compradore, relève de l’espace du politique, au sens où c’est bien d’une lutte antagoniste, d’un conflit irrémédiable entre ami/ennemi qu’il s’agit. Mais, l’organisation du cadre dans lequel s’organise la compétition pour la prééminence dans le camp des adversaires à ces élites compradorisées relève, quant à elle, de la logique agonistique, c’est-à-dire d’un conflit entre adversaires mais non entre ennemis. On comprend immédiatement l’importance de l’articulation entre ce qui relève de l’antagonisme et ce qui relève de l’agonisme. C’est l’une des questions clefs de la lutte politique pour la démocratie. »
Le concept de « compradorisation » mérite un examen attentif mais la construction d’un couple ami-ennemi est selon moi incompatible avec le souci de l’unité nationale.
- Déjà, la conception française et européenne de la guerre fait de l’ennemi une force à vaincre en vue de la paix – non l’incarnation d’un Mal à éradiquer.
- Dans la nation, la lutte entre l’Ami et l’Ennemi s’appelle la guerre civile, qui est une guerre d’extermination pour motifs religieux, idéologiques ou ethniques parce que la différence de l’autre est essentialisée.
- La lutte contre les élites qui constituent l’oligarchie n’est pas un « conflit irrémédiable » aboutissant à l’élimination physique d’une classe ou d’un groupe social.
A l’appui de mon affirmation, je veux évoquer le combat mené de 1940 à 1944, pendant lequel on observe de justes mesures dans l’usage de la violence : élimination physique des nazis, victoire sur l’armée allemande suivie d’une réconciliation, arrestation et jugement des traîtres français au cours d’une révolution qui a entraîné le renouvellement (trop) partiel des élites françaises. J’ajoute que le « parti des politiques » qui a permis de sortir des guerres de religion – Jacques Sapir est l’un de ses héritiers – s’est constitué dans le dépassement de la logique fratricide de l’Ami et de l’Ennemi.
La dernière question que je veux soulever est infiniment plus complexe et mes modestes remarques n’ont d’autre objectif que de prolonger et d’intensifier un débat déjà amorcé (3).
La question est celle des relations entre le pouvoir temporel et l’autorité spirituelle.
Comme mes camarades de la Nouvelle Action royaliste, je tiens ma doctrine de la laïcité de l’enseignement d’Emile Poulat (4) et nous n’avons jamais été pris en faute sur ce sujet. Lecteur de Blaise Pascal, plus que de Jean Bodin, je tiens à la distinction des ordres et je me souviens avoir évoqué très favorablement l’attentat d’Anagni (5) au cours d’une conversation avec François Mitterrand. Je souscris donc à la plupart des réflexions de Jacques Sapir sur la laïcité mais je m’interroge sur la radicalité de certaines formulations :
- « Il ne peut y avoir de peuple, base à la construction politique de la souveraineté populaire, sans la laïcité qui renvoie à la sphère privée des divergences sur lesquelles il ne peut y avoir de discussion ». (page 27). L’impératif laïc est rigoureux si l’on précise que ces « divergences » portent sur l’acte de foi du croyant tel qu’il est formulé par les trois religions monothéistes. Mais ces trois religions ont développé des pensées théologiques et philosophiques qu’il me paraît difficile de placer sur le rayon des idéologies modernes.
- Qu’importe, rétorquera Jacques Sapir, qui plaide pour la relégation : « La souveraineté ne découle pas d’un ordre préétabli. Elle n’existe pas comme le produit d’une religion ou d’une soi-disant nature humaine. Ce qui impose son existence, c’est bien la reconnaissance d’une communauté d’intérêts primordiaux au-delà des conflits engendrés par les intérêts individuels » (page153).
Mais si ! Notre conception de la souveraineté découle d’une religion, et même de deux ! La monarchie royale qui m’est chère trouve son origine dans la pensée juive du politique et la laïcité n’est pas concevable sans le christianisme…
Certes, Jacques Sapir n’ignore rien de l’influence majeure des pensées juive et chrétienne mais il approuve Jean Bodin d’avoir théorisé « l’obligation d’évacuer le fondement divin du pouvoir puis de l’ensemble de la vie sociale » (page 108). Certes, nous pouvons penser que nous avons ôté au pouvoir son fondement divin mais pouvons-nous l’évacuer de la vie sociale ? J’en doute. N’oublions pas que dans la pensée chrétienne le pouvoir est accordé par permission divine sans que celle-ci exclue le consentement populaire : omnis potestas a deo sed per populum. Et si la référence divine a disparu dans la France moderne, le « fondement divin » me paraît marquer encore très fortement notre vie sociale.
Athées ou croyants, nous continuons de raisonner selon une philosophie implicite de la transcendance qui a provoqué maints « retours du refoulé » religieux – y compris pendant la Révolution française (6). Et s’il est vrai que nous continuons de penser avec Platon et Aristote, comment renvoyer à la sphère privée Emmanuel Levinas et Jean-Luc Marion, l’un juif, l’autre catholique ? La philosophie matérialiste et réaliste de Jacques Sapir (7) convient sans doute à plusieurs de mes camarades de la Nouvelle Action royaliste et à bien d’autres Français. Mais sa remarquable cohérence ne permet pas de répondre aux questions d’éthique et de morale – par exemple lorsqu’il s’agit de légiférer sur la médecine. Il faut bien convoquer le catholique Pascal, le protestant Kant et écouter ce que disent les autorités juives, catholiques et musulmanes.
Allons un peu plus loin. Dans une société travaillée par le nihilisme, la quête spirituelle est vive. J’observe que les autorités juives, chrétiennes et musulmanes sont aujourd’hui des facteurs importants de paix civile face aux provocations djihadistes et aux propagandistes de la guerre des civilisations. Jacques Sapir ne contestera pas ce point, lui qui écrit que la distinction des domaines politique et religieux n’exclut pas la coopération. Mais admettra-t-il que les trois religions monothéistes offrent des ouvertures sur l’universel qui peuvent permettre, entre croyants et incroyants, des dialogues publics et féconds ? Je crains que non. Jacques Sapir concède une place dans la société aux traditions religieuses mais affirme (page 152) que « c’est bien dans une exclusion de la place publique des revendications religieuses et identitaires que pourra se construire la paix civile. » Et d’ajouter que « le registre du religieux […] est désormais un piège pour qui veut construire du social, et donc du vivre-ensemble. » S’il faut effectivement exclure les revendications religieuses et identitaires du domaine public, on ne saurait réduire les diverses institutions religieuses à un syndicat revendicatif de défense des intérêts religieux !
Toute société humaine repose sur un système de médiations. Plus le système est complexe, plus la société a des chances d’assumer paisiblement ses conflits. Les médiations politiques ne sauraient exclure les médiations spirituelles. Je propose un projet politique, la monarchie royale, qui se situe dans le cadre de la République laïque. Il ne m’appartient pas de dire comment pourraient se nouer ou se renforcer les liens entre les médiations spirituelles et temporelles. La parole est aux philosophes et aux théologiens. Cela dit, je me retrouve pleinement avec Jacques Sapir lorsqu’il cite Henri IV : « Il n’y a d’irrémédiable que la perte de l’État ». Le premier point de notre programme commun, c’est bien le salut de l’État.
***
(1) Cf. sur ce blog : http://www.bertrand-renouvin.fr/frederic-lordon-jacques-sapir-et-lembrouille-souverainiste-chronique-83/
(2) Cf. l’article de Jacques Sapir sur Podemos et le populisme http://russeurope.hypotheses.org/4596
(3) Cf. le débat entre Jacques Sapir et Gérard Leclerc : “Quelle souveraineté pour la France”, Le Figaro magazine, 8 janvier 2016.
(4) Cf. Emile Poulat, Notre laïcité ou les religions dans l’espace public, DDB, 2014.
(5) En septembre 1303, une forte troupe commandée par Guillaume de Nogaret investit la ville d’Anagni et pénètre dans le palais pontifical afin de notifier à Boniface VIII une assignation à comparaître devant le concile œcuménique que le roi de France a décidé de réunir à Lyon en vue de la déposition du pape.
(6) Cf. Lucien Jaume, Le religieux et le politique dans la Révolution française. L’idée de régénération, Collection Léviathan, PUF, 2015.
(7) « L’ordre démocratique se veut et se définit comme une conception à la fois matérialiste (au sens où elle n’implique pour sa définition ou sa compréhension aucune référence religieuse et n’ont donc pas contradictoire avec aucune des religions professées par les citoyens et réaliste de l’organisation des sociétés. » Jacques Sapir, op. cit. page 214.
SOURCE : http://www.bertrand-renouvin.fr/#sthash.gg9MHV6j.dpuf
Remarques sur un texte de Renouvin
Bertrand Renouvin m’a fait l’amitié d’un long compte rendu de mon ouvrage Souveraineté, Démocratie, Laïcité[1], compte rendu qui a été publié en trois parties sur son blog.
Partie 1 : http://www.bertrand-renouvin.fr/jacques-sapir-theoricien-de-la-souverainete/#sthash.HrEQYK3Q.dpuf
Partie 3 : hthttp://www.bertrand-renouvin.fr/#sthash.s8nMe5QV.dpuf
Je dois dire tout d’abord que je suis immensément honoré de cette recension. Elle n’est pas sans critiques ; les plus belles des roses ont aussi leurs épines. On sait ce qui nous rapproche, et les points sur lesquels nous pouvons être largement en accord. Je voudrais donc ici revenir sur deux points qui sont évoqués en particulier dans la troisième partie de la recension de mon livre.
Le couple Ami/Ennemi
Le premier point porte sur la distinction Ami/Ennemi que j’emprunte à Carl Schmidt. Bertrand Renouvin craint que l’usage de cette distinction ne soit contradictoire avec l’idée de la paix civile et de l’union nationale, et il écrit ainsi : « …la construction d’un couple ami-ennemi est selon moi incompatible avec le souci de l’unité nationale. Déjà, la conception française et européenne de la guerre fait de l’ennemi une force à vaincre en vue de la paix – non un l’incarnation d’un Mal à éradiquer. Dans la nation, la lutte entre l’Ami et l’Ennemi s’appelle la guerre civile, qui est une guerre d’extermination pour motifs religieux, idéologiques ou ethniques parce que la différence de l’autre est essentialisée. La lutte contre les élites qui constituent l’oligarchie n’est pas un « conflit irrémédiable » aboutissant à l’élimination physique d’une classe ou d’un groupe social ».
Le problème est que, s’il faut être deux pour négocier, la décision d’un seul fait basculer la situation dans le conflit. Nous avons été le témoin, et je sais qu’il fut tout autant horrifié que moi, de la brutalité et de la violence des moyens dont l’oligarchie européenne a usés dans son conflit avec le gouvernement grec au premier semestre de 2015. S’il n’était pas question de « l’élimination physique d’une classe » il était clair que les objectifs de cette oligarchie n’étaient ni le bien-être du peuple grec, ni même les intérêts à long terme de l’Union européenne, mais purement la destruction de ce que représentait alors le gouvernement de SYRIZA. Ceci a bien constitué une forme de «guerre d’extermination pour motifs religieux, idéologiques » menée par cette oligarchie. Comment ne pas voir que ce qui était en cause était bien une relation Ami/Ennemi ?
Quand Bertrand Renouvin soulève le problème de la contradiction entre cette notion et celle de l’Union national, il pose en réalité la question des contours de l’union nationale. Nous savons que, dans le combat mené par la Résistance contre les forces d’occupation et du gouvernement de Vichy, il n’y eut, progressivement, plus de terrain d’entente possible. La défaite signifiait la mort ou l’exil, la victoire le démantèlement des positions de pouvoir de l’adversaire, et pour reprendre les mots qu’il utilise : « …élimination physique des nazis, victoire sur l’armée allemande suivie d’une réconciliation, arrestation et jugement des traîtres français au cours d’une révolution qui a entraîné le renouvellement (trop) partiel des élites françaises». Il ne peut y avoir d’union nationale avec ceux qui se sont mis, de par leurs actes, hors de la communauté nationale. Mais, la relation Ami/Ennemi n’interdit pas, après la victoire, des formes de réconciliation. Encore faut-il en préciser les formes et les conséquences. Ce qui distingue un « Ennemi » ce n’est pas sa « nature » c’est son projet politique. Qu’il y renonce, et sa réintégration dans la communauté nationale devient possible.
Bien sûr, pas à n’importe quelle conditions. La réintégration n’est possible qu’une fois la dette à la Nation payée (et c’est le sens des condamnations en justice) et qu’une fois les moyens de nuire à cette dernière enlevés (et c’est le sens des nationalisations qui furent prononcées après la guerre). Cette réconciliation doit aboutir à une loi d’amnistie, c’est à dire une loi organisant l’oubli juridique et politique des actes commis. Car, si l’existence de la communauté nationale exige de la mémoire, elle peut aussi exiger que l’on ne fasse plus mention au sens légal et politique, de certains actes. Ces derniers sont sortis du registre de la lutte politique pour être intégrés à celui de la mémoire. Notons aussi qu’une loi d’amnistie n’est possible, au sens de sa légitimité, qu’une fois la condamnation exécutée et les moyens de nuire enlevés. Mais, ceci fait, l’amnistie devient impérative.
Bertrand Renouvin me fait l’insigne honneur de ma comparer aux « Politiques » du temps des guerres de religion. C’est là que je prendrai un exemple fameux.
Quand Henri IV se réconcilia au Duc de Mayenne, principal chef de la Ligue et du parti ultra-catholique depuis la mort du Duc de Guise, il ne le fit pas sans prendre des précautions et sans obtenir que Mayenne le reconnaisse comme roi véritable et légitime[2]. Les conditions du conflit qui avait opposé le Roi, les protestants et les « politiques » aux ultra de la « Ligue », correspondaient bien à cette opposition Ami/Ennemi et à cet affrontement sans merci ni pitié entre deux camps que tout opposait. Mais, cette déclaration ôtait symboliquement la capacité à Mayenne de nuire à la France et à Henry IV. Elle était la condition même de l’amnistie, c’est à dire du « Pardon Royal ».
L’amnistie apparaît donc en réalité comme intimement liée à la distinction Ami/Ennemi.
C’est parce que cette distinction a été mobilisée qu’il faut à un moment donné pouvoir sortir de cette distinction. Mais, cette sortie, on le répète, ne peut se faire sans des conditions bien précises. Mais, la distinction Ami/Ennemi n’a pas que le fait de donner un rôle important à l’amnistie. Elle permet aussi de distinguer le cercle des adversaires, ce que j’ai appelé à la suite de Chantal Mouffe, le cercle des relations agonistiques.
Ce sont des relations rendues justement nécessaires par l’existence de la relation Ami/Ennemi entre personnes qui peuvent s’opposer sur un certain nombre de points mais qui sont unis par la dynamique du conflit entre Ami/Ennemi. L’oligarchie s’est mise d’elle-même en dehors de la communauté nationale et elle usera de tous les moyens, y compris – il faut le craindre – des moyens terroristes pour obtenir sa victoire. Ce serait une dangereuse folie de ne pas le reconnaître et de ne pas agir en conséquence.
De la laïcité
Les deuxième point porte sur la relation aux religions révélées (Judaïsme, Chrétiens et Musulmans). Ces religions ont ceci de particulier qu’elles partagent une source commune. Il fait alors un constat factuel que l’on partage : « Athées ou croyants, nous continuons de raisonner selon une philosophie implicite de la transcendance qui a provoqué maints « retours du refoulé » religieux – y compris pendant la Révolution française ». Mais, n’est-ce pas à dire que le « besoin de croire » caractérise la conscience à partir d’un certain niveau de cette dernière. Il y a des croyances qui ne se donnent pas comme telles, mais qui partagent avec les religions bien des caractéristiques, comme la croyance dans le « progrès », voire dans l’Euro. Le problème vient d’une part de l’organisation, plus ou moins hiérarchisée, de ces croyances.La constitution de l’Église Catholique sur le modèle de l’empire romain nous fait rentrer dans le monde politique.De même, la confusion entre le monde du religieux et celui du politique que l’on retrouve dans une partie de la religion musulmane oblige qui veut analyser les effets de ces religions de la considérer au-delà de leurs discours comme des instruments potentiels de domination politique, instruments qu’il convient de limiter et de discipliner si l’on veut maintenir la paix civile.
Il fait alors cette remarque : « Mais admettra-t-il que les trois religions monothéistes offrent des ouvertures sur l’universel qui peuvent permettre, entre croyants et incroyants, des dialogues publics et féconds ? Je crains que non. » Effectivement, ces religions, et certainement d’autres mais qui sont tellement minoritaires que l’on peut les exclure pour un temps de l’analyses, ne sont pas « que » des ouvertures sur l’universels. Elles sont aussi des instruments de domination politique. C’est pourquoi autant je suis prêt à reconnaître ce que doit notre civilisation européenne sur le plan philosophique à un dialogue des religions (ce dialogue d’ailleurs dépassant les trois religions citées et incluant les religions grecques et romaines), je maintiens que ce dialogue doit être relégué à la sphère privée.
Bertrand Renouvin ajoute alors : « S’il faut effectivement exclure les revendications religieuses et identitaires du domaine public, on ne saurait réduire les diverses institutions religieuses à un syndicat revendicatif de défense des intérêts religieux ! ». Assurément ; mais on doit reconnaître que c’est – hélas – très souvent ainsi que se comportent leurs représentants. Et ce type de comportement est constamment reproduit par la logique de la croyance à partir du moment ou celle-ci s’incarne dans des rites, dans des cultes organisés.
Nous avons tous besoin de croire. Mais, que l’on nous laisse libre de choisir nos croyances particulières, et de fait l’athéisme est une forme particulière de croyance, et les valeurs qui vont avec. Par contre, entendons-nous sur les principes qui nous permettent de vivre en société. Et il y en a un sur lequel nous serons pleinement d’accord : c’est bien le salut de l’État.
[1] Publié aux Editions Michalon, à Paris, en janvier 2016.
[2] Babelon J-P, Henri IV, éditions Fayard, Paris, 1997

